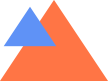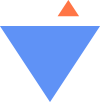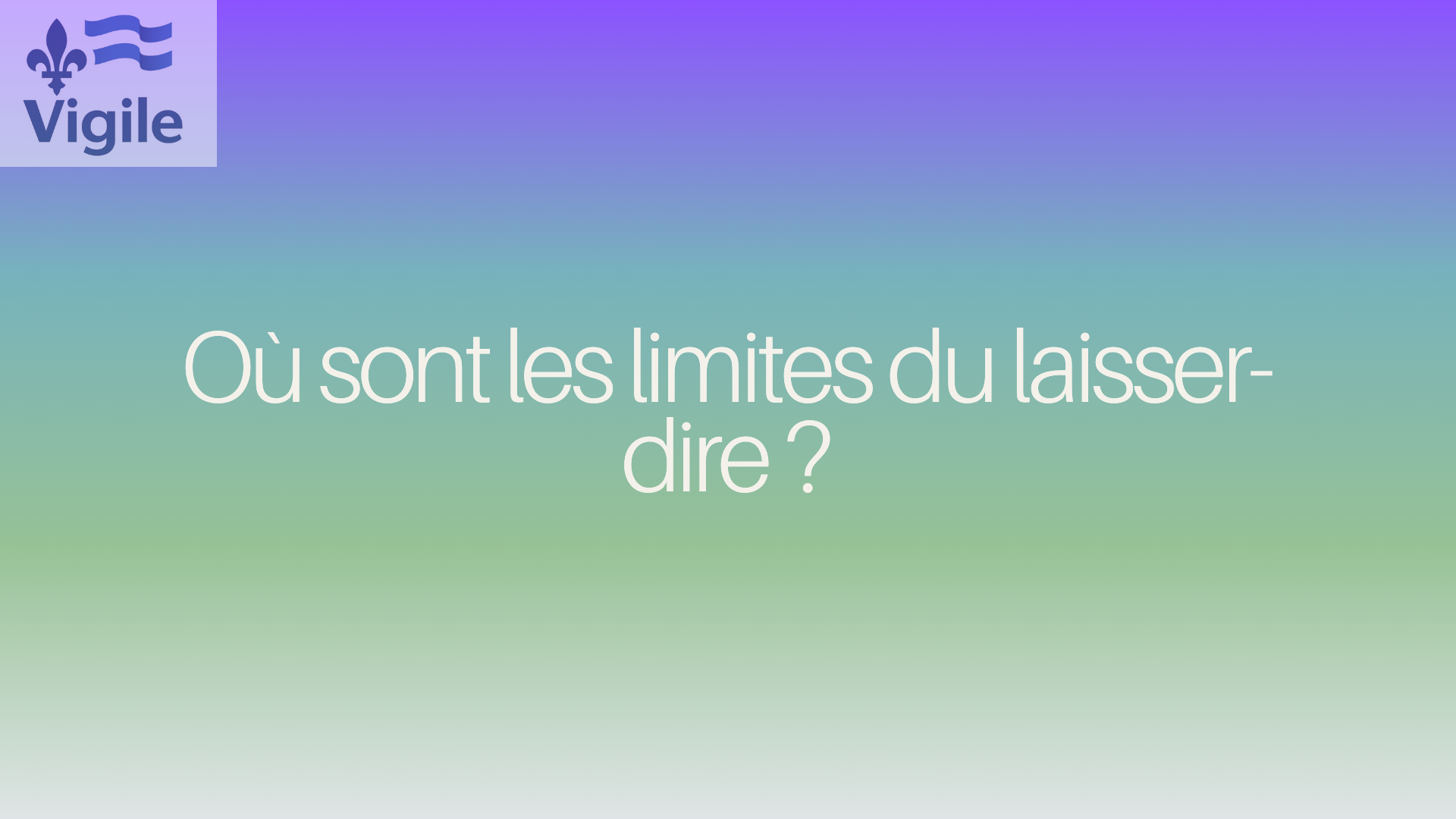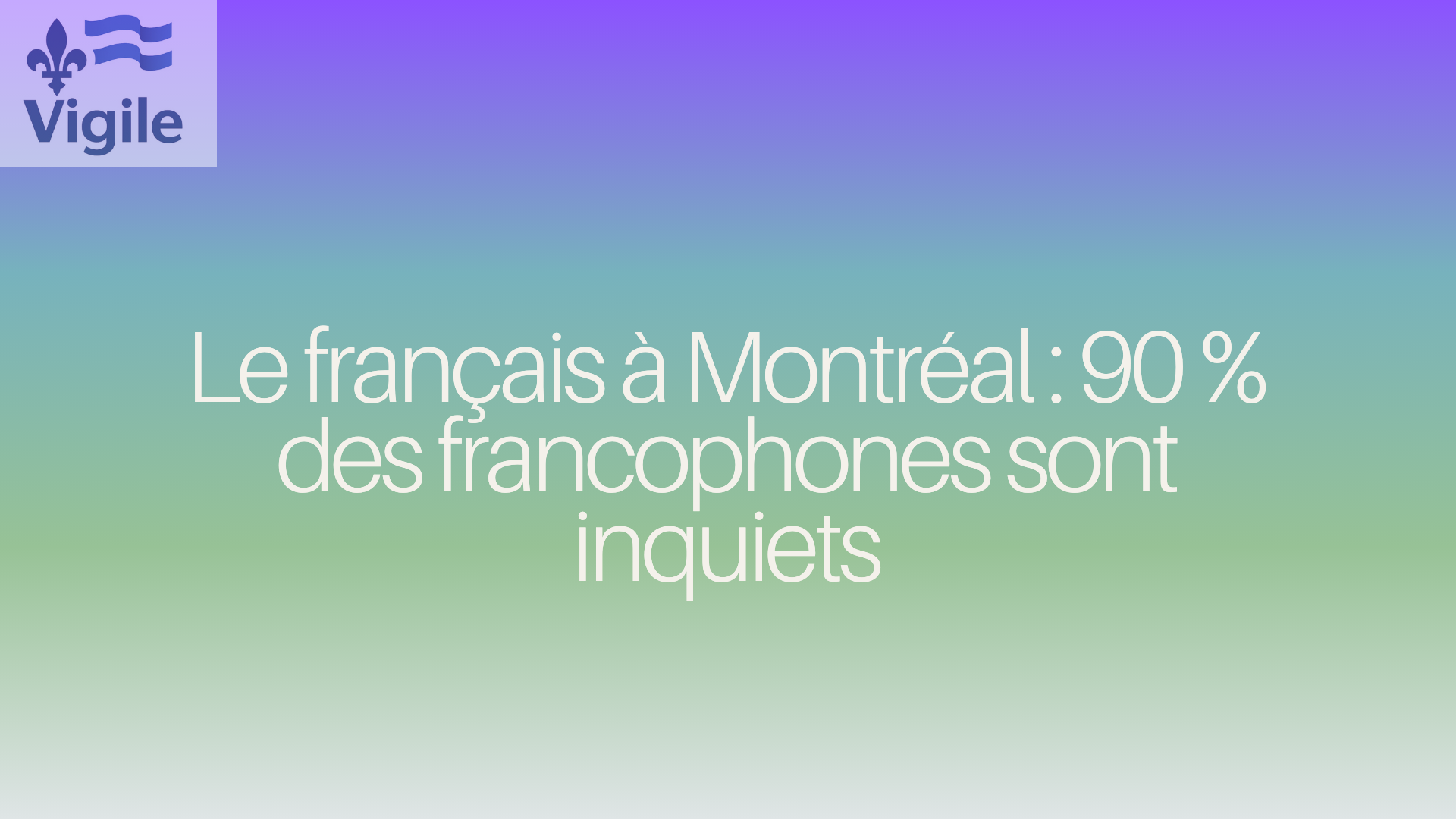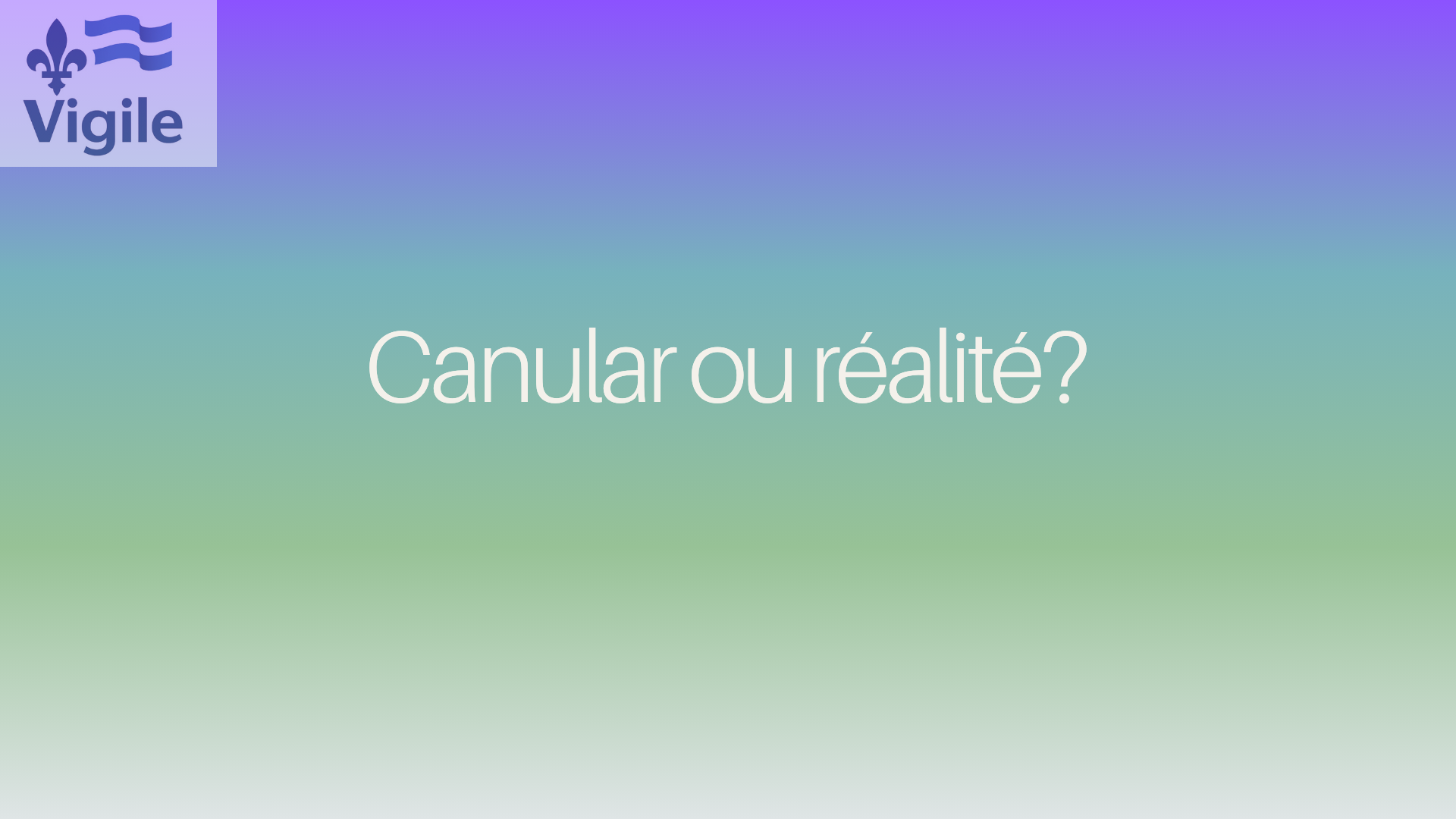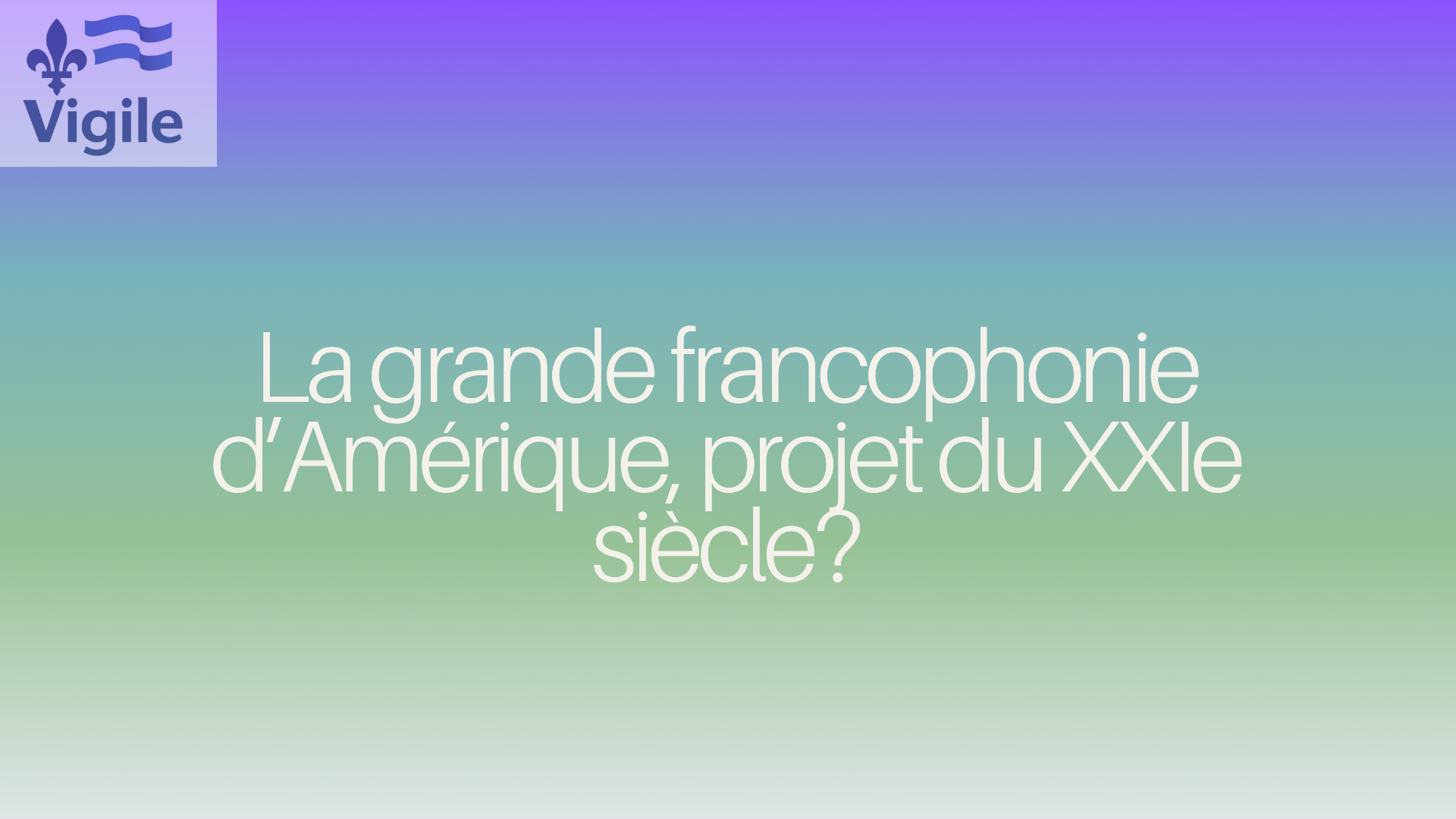Depuis plusieurs années, les accusations contre le Québec et son nationalisme s’intensifient. Ce climat de suspicion n’est pas nouveau, mais le « presque-OUI » du référendum de 1995 a marqué un tournant dans la manière dont le Québec est perçu, particulièrement à l’extérieur de ses frontières. Plutôt qu’un débat franc et ouvert au sein de l’espace public canadien, on assiste à un procès à distance, souvent dans les médias étrangers ou anglophones canadiens, où le Québec – sa société, ses institutions, son gouvernement et sa population – est jugé collectivement.
Une rhétorique alarmiste
À la veille du référendum de 1995, certains médias avaient déjà donné le ton. Le Financial Post évoquait alors l’idée d’emprisonner Jacques Parizeau pour haute trahison. Peter C. Newman, dans Maclean’s, allait jusqu’à appeler à une intervention militaire contre le Parti québécois. Sur les forums en ligne, les propos délirants se multipliaient : des théories conspirationnistes présentaient Lucien Bouchard comme un agent de Washington, contaminé par la CIA pour le transformer en martyr de la cause souverainiste.
Le Ottawa Sun comparait le PQ et le Bloc québécois au Front national français. D’autres évoquaient la « ghettoïsation » du Québec, accentuant l’image d’un peuple replié sur lui-même, hostile aux anglophones et aux minorités culturelles. Des figures médiatiques populaires au Canada anglais ne se gênaient pas pour dépeindre les Québécois comme des enfants gâtés de la fédération, dépendants des transferts fédéraux et ennemis des libertés individuelles.
Un procès médiatique à grande échelle
L’offensive médiatique ne s’est pas limitée au Canada. Le Boston Globe publiait en première page que les « séparatistes font fuir les anglophones et nuisent à l’économie », citant même un psychologue affirmant que la moitié de la population québécoise souffrait d’insomnie chronique en raison du climat d’incertitude politique. The Economist, The Wall Street Journal, Mexico City Times, Scottland On Sunday, The Baltimore Morning Sun… tous ont contribué à propager une image caricaturale et anxiogène du Québec.
Ces discours alarmistes, relayés d’un chroniqueur à l’autre, d’un éditorial à un tweet, ont parfois des accents de désinformation. Même des figures fédéralistes comme Jean Paré (L’Actualité) ou Roger D. Landry (La Presse) se sont inquiétés du ton employé, le comparant parfois aux dérives d’une « radio mille collines ».
Où tracer la ligne?
Dans ce contexte, une question s’impose : jusqu’où peut-on aller dans la diabolisation d’un peuple sans que cela ne devienne, en soi, une forme d’intolérance? Les débats autour de la langue, de la laïcité ou de l’indépendance du Québec méritent mieux qu’une caricature médiatique. Ils appellent à une réflexion nuancée sur les identités, la démocratie, et le droit à l’autodétermination – des enjeux universels, pas uniquement québécois.